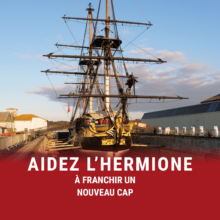Définition et différences de statut entre les pirates et les corsaires
Qu’est-ce qu’un pirate ?
Le mot pirate vient du latin “pirata” : celui qui tente la fortune. Un pirate est un hors-la-loi parcourant les mers et pillant les navires sans distinction et pour son propre compte. Il n’est soumis à aucun code d’honneur si ce n’est le sien, le code des pirates. Les pirates ne font allégeance qu’à eux-mêmes et ne travaillent pas pour le compte du gouvernement. Cela implique que tous les crimes sont permis sans restriction. Les actes de piraterie sont sévèrement punis car un pirate arrêté est pendu sans aucune forme de procès. La société considère le pirate comme un bandit et il ne jouit donc d’aucun droit à la différence du corsaire.
Qu’est ce qu’un corsaire ?
Le nom corsaire, dérivé du latin “cursus” veut dire “cours”. Il fait référence à un bâtiment (navire) qui, en temps de guerre, était armé en vertu d’une commission du gouvernement. Les bateaux corsaires étaient mandatés par le gouvernement pour mener l’abordage sur des navires ennemis. C’est là toute la différence avec les pirates. Le corsaire attaque des navires marchands appartenant aux ennemis de la couronne et ne s’en prend qu’au butin.
Le gouvernement protège les corsaires par un ordre de course (lettre de course). Ils sont soumis à des règles et ne pillent que sur demande.
A la différence des pirates, les corsaires, grâce à leurs lettres de course, ne sont pas pendus lorsqu’ils sont arrêtés. Ils sont considérés comme des prisonniers de guerre en attente de jugement et ont les mêmes droits.
Le Nouveau Monde abrite beaucoup d’histoires de pirates qui sont anglais, irlandais, espagnols ou portugais. Mais de nombreux corsaires et pirates reconnus étaient français.
Parmi eux, il est difficile de ne pas citer Jean Bart, le corsaire qui sauva la France de la famine. Nous retiendrons aussi parmi les pirates célèbres de France le nom de François l’Olonnais, particulièrement sanguinaire, dont la cruauté était telle qu’elle lui a valu le surnom de “Fléau des Espagnols”. Il s’attaquait tout particulièrement aux navires Portugais et Espagnols. Il connut une fin tragique : capturé sur les côtes du Panama après le naufrage de son vaisseau, il fut dévoré par des indiens cannibales.
Les corsaires au service de la couronne
Les corsaires ne sont pas des membres à part entière de la Marine royale car ils ne sont appelés qu’en temps de guerre. Ils sont autorisés à attaquer uniquement s’ils ont la lettre de marque de leur gouverneur. Les navires qui sont pris sont saisis et une partie du butin sert à payer la couronne. Le reste est pour le capitaine corsaire et ses hommes. Une fois la guerre terminée, le corsaire n’est plus sous mandat et donc plus lié à la couronne. Cependant, pendant les combats ils sont considérés au même titre que les matelots de la Marine royale.
De corsaire à pirate, il n’y a qu’une lettre de marque
Puisque le corsaire n’est pas membre de la Marine royale, aussitôt que les combats cessent, il se retrouve au chômage. Nombreux sont les corsaires qui, d’abord au service du roi, sont finalement devenus brigands. Les lettres de marque protègent et payent les corsaires le temps de la bataille mais une fois terminée, ils n’ont plus de moyen de subsistance. Excellents marins qu’ils sont, ils sont entraînés et aussi expérimentés que les pirates pour le pillage et la capture des riches navires marchands. Les anciens corsaires savent que les cargaisons des expéditions commerciales sont pleines de denrées précieuses. Préférant la piraterie à la pauvreté, certains d’entre eux délaissent les ordres de leur souverain pour s’adonner au brigandage.
Le cas spécifique des flibustiers
Le flibustier est un pirate de la mer des Antilles. Il œuvre notamment au XVII et XVIIIe siècle et uniquement dans la mer des Caraïbes. Les flibustiers ont un mode opératoire proche de celui des pirates car ils donnent l’assaut pour eux-même, mais peuvent être ponctuellement appelés à passer contrat avec les gouvernements lorsque ceux-ci manquent d’équipage.